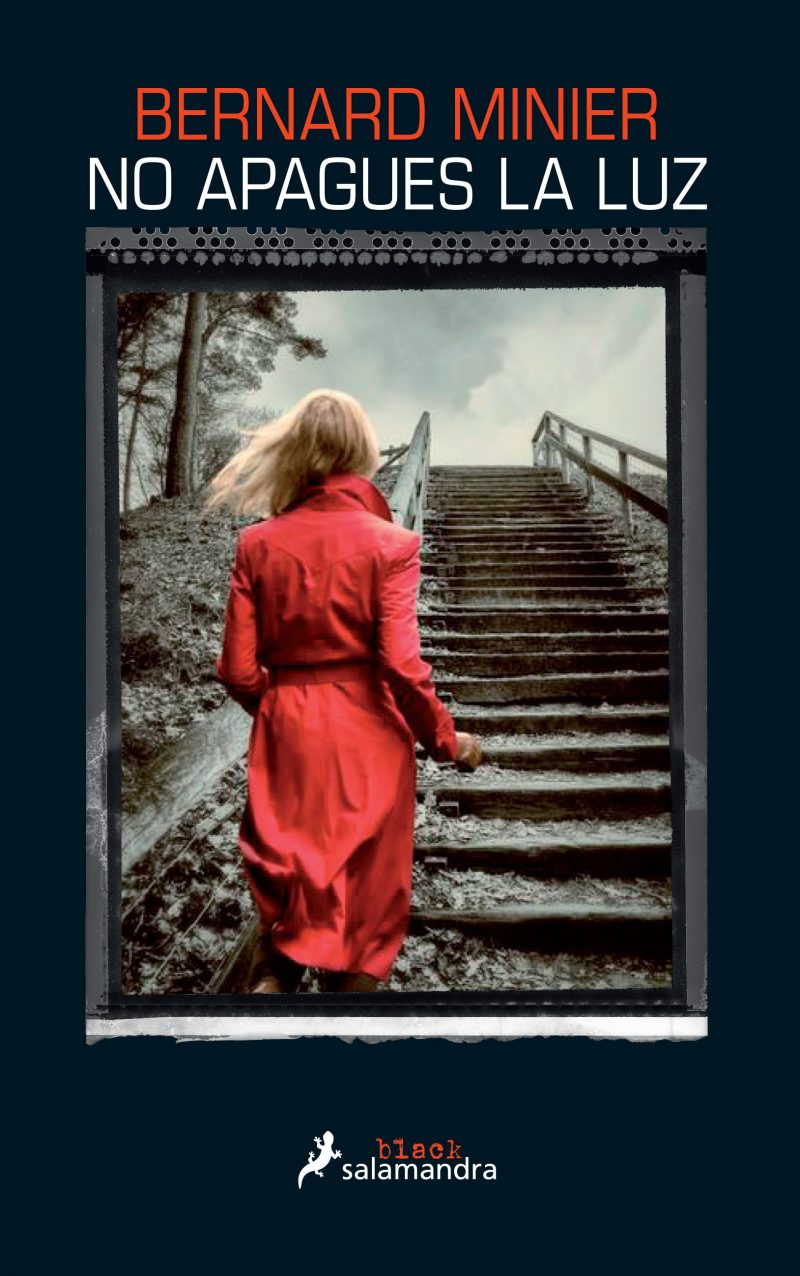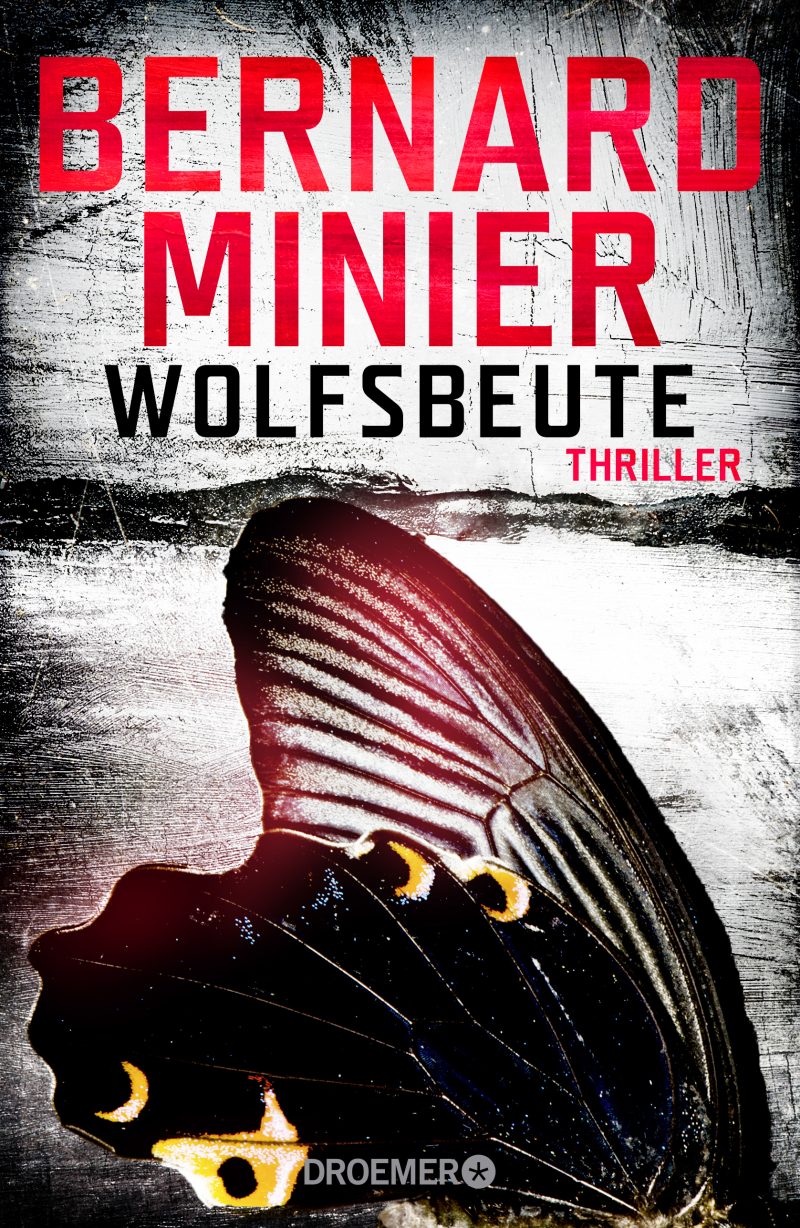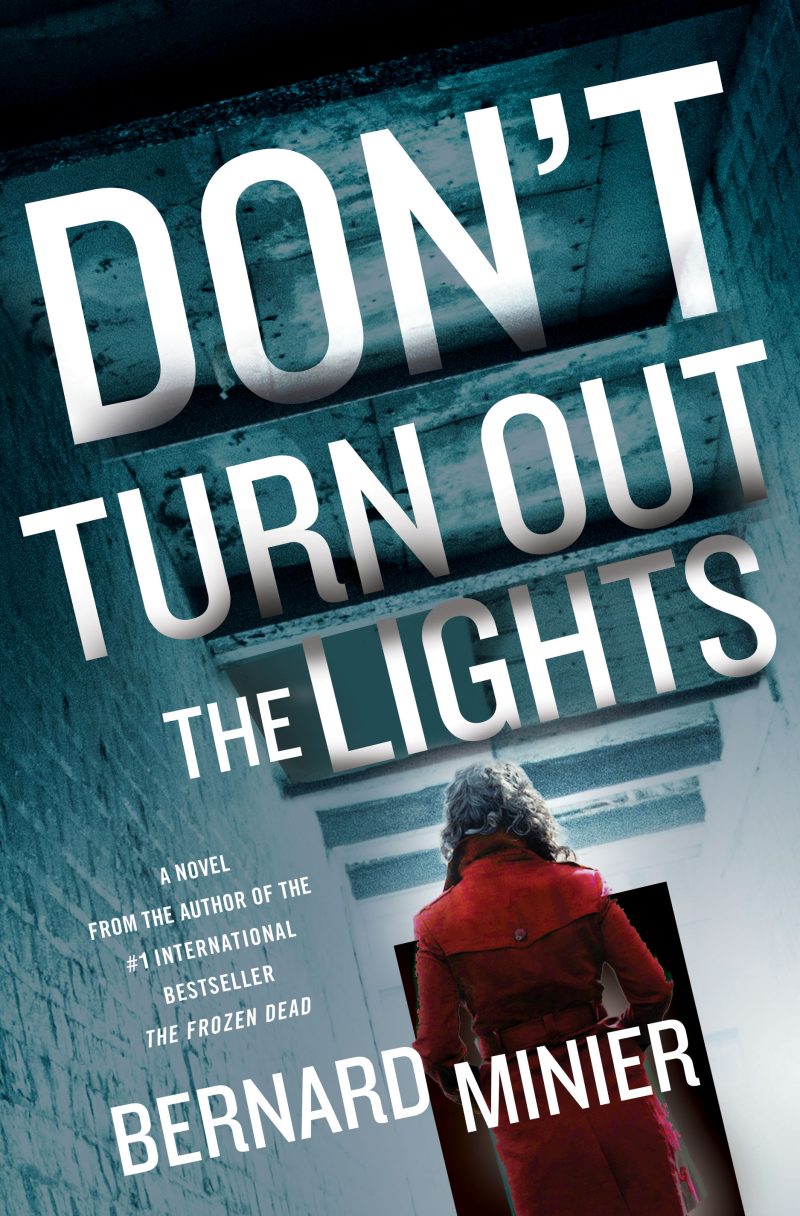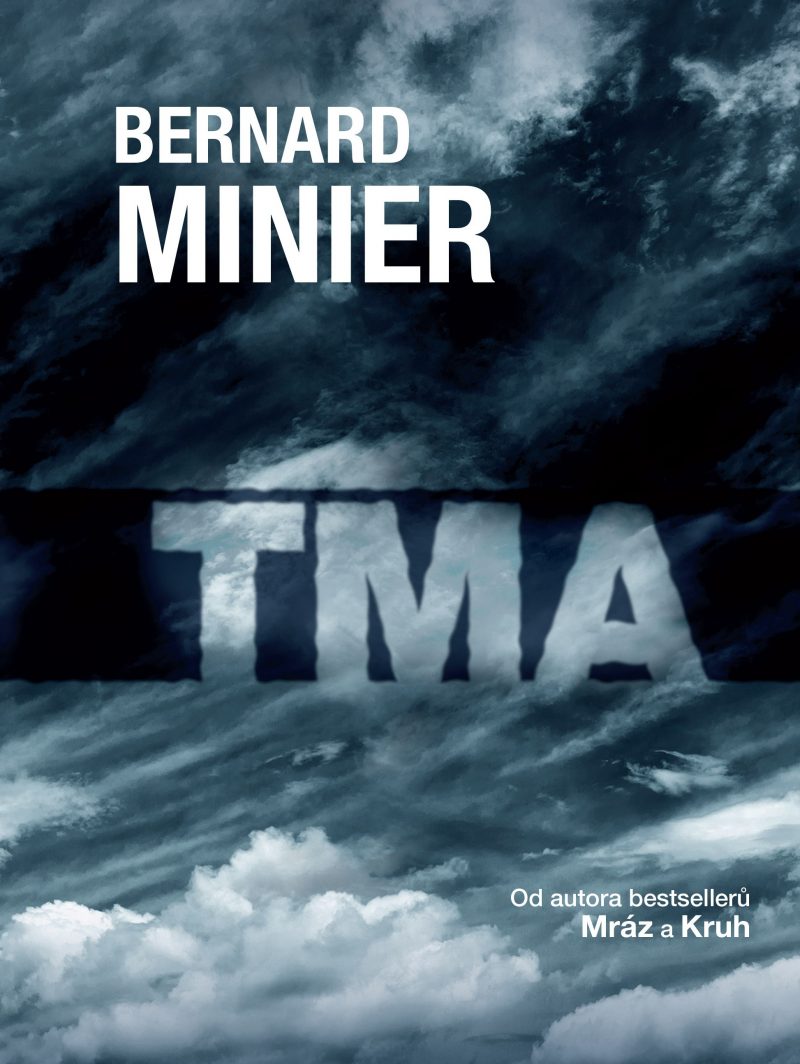C’est une idée que j’avais en tête depuis longtemps. Mais elle s’est véritablement précisée alors que je volais vers l’Argentine où j’étais invité à un festival, en 2012. Plus de quarante heures d’avion aller-retour pour quatre jours de festival, la plupart de nuit au-dessus de l’Atlantique – pour quelqu’un qui a peur de l’avion… ! Je savais qu’aucun roman ne m’accaparerait assez pour me faire oublier cette peur. Alors, outre une petite pilule, je me suis plongé dans un livre intitulé Femmes sous emprise, de Marie-France Hirigoyen. Un livre fascinant, terrifiant, sur la manipulation et l’emprise. Tout y était : le conditionnement des victimes, leur vulnérabilité, le harcèlement, les actes d’intimidation, les menaces, le contrôle, l’isolement… Je prenais des notes, furieusement, demandais des cafés à l’hôtesse amusée par mes feuillets noircis et dispersés un peu partout (je m’étais étalé sur les sièges voisins, inoccupés), les idées fusaient alors que la cabine était plongée dans le noir et que presque tout le monde autour de moi roupillait et, quand on a atterri à Buenos Aires au petit matin, je n’avais pratiquement pas fermé l’œil de la nuit mais je tenais mon histoire.
Pourquoi ce thème de la manipulation et de l’emprise ? D’où vient-il ?
Du fait que, tout simplement, ce thème me fascine depuis longtemps et qu’il est celui de quelques-uns de mes films et de mes romans préférés. J’adore les films mettant en scène des persécutions, comme le très rigolo Liaison Fatale, les romans fonctionnant sur le registre de la paranoïa. Prenez un classique de la littérature : Les Hauts de Hurlevent. Ou un classique du cinéma : Rebecca, de Hitchcock, et sa fameuse scène où Joan Fontaine est poussée au suicide au bord d’une fenêtre de Manderley par la perverse Mrs Danvers. Prenez les films paranoïaques de Polanski : Rosemary’s Baby, où Rosemary découvre progressivement qu’elle est enceinte du démon et que ses si serviables voisins de palier tout comme son cher mari sont des satanistes, ou encore Le Locataire, où ce malheureux Trelkovsky est poussé au suicide par les habitants de son immeuble tout comme l’avait été avant lui la précédente locataire.
Mais je ne voulais pas seulement ourdir une manipulation, aussi machiavélique fût-elle, je voulais absolument être au plus près de mon personnage, coller à lui (ou plutôt à elle) comme une sangsue (ou comme son ombre, si vous préférez), la suivre partout : dans l’ascenseur, dans la cave, dans sa chambre à coucher. Scruter la moindre de ses réactions. Parce que c’est ça l’essence du thriller : des émotions. Et c’est par le biais de ces émotions que le lecteur reçoit d’abord ce que l’auteur a à lui dire.
Comment travaillez-vous ? Vous avez été contrôleur des Douanes, quelles méthodes en avez-vous gardé ?
Ma méthode, si j’en ai une, c’est de constituer des dossiers sur tous les aspects du livre : de l’espace à l’opéra en passant par le harcèlement et la violence psychologique au sein de l’entreprise et du foyer, de lire une abondante littérature sur les sujets abordés, et surtout d’aller sur place, de rencontrer des gens, de poser des questions : c’est là, je crois, que se fait la différence. J’ai la chance d’avoir de très bons contacts dans la police de Toulouse. Sans eux, je ne sais pas comment j’aurais fait ! Tout ce qu’ils me montrent, m’expliquent n’est ni dans les livres ni sur Internet ! Certains sont même devenus des amis. À chaque étape, j’échange avec eux et je vais sur place. Plus le matériau dont dispose au départ un auteur est authentique, plus ce qu’il inventera ensuite sera intéressant et loin des clichés. Les auteurs américains ont particulièrement ce souci documentaire du détail vrai. Même un auteur de fantastique comme Stephen King se documente, va à la rencontre de spécialistes. C’est quelque chose que je respecte.
Après, pendant la phase d’écriture, j’emploie ce qu’Elizabeth George appelle la « colle à cul » : assiduité, discipline – rien qui fasse rêver… Il y a très longtemps, mon père, avant de devenir professeur, a été meilleur ouvrier de France ; je crois que j’ai toujours considéré le travail comme une vertu – même quand, étudiant, j’étais fort peu vertueux de ce côté-là (j’étais rarement levé avant l’après-midi en ce temps-là et – croyez-le ou non – j’avais les cheveux longs et gras.)
À quelle famille littéraire vous sentez-vous appartenir, dans les polars et dans les thrillers ?
Au fond, je suis un apatride de l’écriture : je ne me sens d’aucune famille. Peut-être parce que je suis venu au polar sur le tard et que j’ai lu très tôt des littératures étrangères. Je me souviens que, de la sixième à la première, mes professeurs de français respectifs, compte tenu de mes bons résultats, me prenaient chaque fois sous leur aile et essayaient de m’imposer des lectures supplémentaires pour former mon goût et mon jugement. Mais j’ai toujours été une forte tête. Déjà à cette époque, je négligeais souvent leurs conseils pour dévorer avec passion les littératures allemande, américaine, espagnole, italienne, anglaise… tout comme je dévorais essais et poésie. Quand j’étais lycéen dans le Sud-Ouest puis étudiant à Toulouse (en fac de médecine, pas de lettres, au grand dam de mes anciens professeurs), mes idoles s’appelaient Thomas Bernhard, Nabokov, Günter Grass, Pasolini, Anthony Burgess… Toutes proportions gardées, ce besoin d’atmosphères hivernales et d’enfermer mes personnages dans des lieux étouffants, par exemple, me vient sans nul doute du souvenir des lectures passionnées et extatiques de Perturbation, de La Plâtrière, de Gel, les premières œuvres du génial imprécateur autrichien, tout autant que d’avoir grandi au pied des Pyrénées.
Plus tard, ça a été Faulkner, Salinger, Gombrowicz, et puis la poésie de Garcia Lorca, de Machado, de Neruda tandis que je parcourais l’Espagne sans un rond, on the road, au moment où ce pays découvrait les charmes et les vertiges de la démocratie… Mais aussi des perles fantastiques comme les géniaux Books of Blood de Clive Barker et l’œuvre immense de King – le seul équivalent contemporain de la Comédie humaine… J’ai découvert plus ou moins le polar (j’avais quand même lu Edgar Poe, Conan Doyle et Patricia Highsmith avant ça) à travers Mankell. Je l’ai immédiatement aimé. Il y avait une petite musique chez lui. Et ses personnages étaient crédibles, vivants ; ils étaient comme vous et moi… Et puis, il y a eu Ellroy, Lehane, Connelly, Jonquet, Manchette… Plus récemment Nesbo – beaucoup d’autres… Elle est là, ma famille : dans mes lectures.
Le décor est très présent dans vos romans. Quel rôle joue-t-il ? Quelle importance a-t-il pour vous ?
Je pars toujours d’une atmosphère, d’un décor. Peut-être parce que j’ai une écriture visuelle. Et parce qu’en tant que lecteur j’aime les romans où l’atmosphère est très présente et pesante. J’adore aussi inventer des géographies fictives, comme dans ces livres qui commençaient par une carte que je parcourais, enfant, avec délice. Elle était déjà une promesse d’évasion. Ici, toutefois, pas de ville imaginaire comme c’était le cas avec Marsac et Saint-Martin-de-Comminges. Ici, le décor, c’est Toulouse même. Toulouse sous la neige… Et qu’on ne s’avise pas de me dire que ça n’existe pas : je me souviens d’un épisode en 2012 où nous avions accompagné, mon éditrice allemande et moi, des journalistes venus tout exprès d’Allemagne dans les Pyrénées, sur les lieux véritables qui ont inspiré ceux de Glacé. Au retour, après avoir joyeusement batifolé dans la neige pendant trois jours, nous avons vu nos vols annulés à l’aéroport de Toulouse-Blagnac et la ville était si farcie de neige que les bus avaient cessé de circuler. Avec deux cents autres personnes nous avons attendu des taxis qui arrivaient au compte-gouttes dans le froid et les flocons, et nous avons finalement pris un train pour Paris le lendemain. C’est sans doute à ce moment-là qu’est né le décor de N’éteins pas la lumière.
Dans vos romans, la musique a une place importante. Parlez-nous de l’opéra qui est la bande originale de votre roman…
J’ai mis de la musique dans mes trois romans parce que la musique est très présente dans ma vie – comme elle l’est, du reste, dans celle de la plupart de mes contemporains : regardez combien de personnes sont capables d’échanger sur des goûts musicaux communs et combien peu le sont sur des lectures communes… J’ai découvert, à travers un livre en particulier : L’Opéra ou la défaite des femmes, de Catherine Clément, le destin presque invariablement tragique des femmes dans l’opéra : trahies, bafouées, assassinées, suicidées, acculées à la folie ou à la mort et j’en passe… C’est incroyable le nombre de personnages féminins qui se suicident à l’opéra ! Le malheur des femmes a de toute évidence et de tout temps fait les délices des amateurs d’opéra (je dis cela sans malice aucune). Sans être un spécialiste, j’en écoute assez régulièrement et il y a des passages qui me serrent le cœur à chaque fois – et je ne vous dis pas quand ils sont associés à des images de cinéma… Le cinéma et l’opéra, c’est la flamme et l’essence : comme dans cette scène bouleversante de Philadelphia où le personnage de Tom Hanks, atteint du sida, fait écouter à son avocat l’aria de la Mamma Morta, chanté par Maria Callas, lui en explique les paroles terribles, le contexte dramatique, en dansant et en pleurant, son porte-perfusion à la main. Il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas être remué par une telle scène. L’opéra, c’est le domaine des émotions pures, comme l’est à sa façon le thriller. À partir de là, dans un livre où les femmes sont aussi présentes (et aussi maltraitées), il m’a semblé que l’opéra s’imposait naturellement comme fil rouge. Toutes les têtes de chapitre sont du reste tirées du vocabulaire lyrique. Et le roman est construit un peu à la manière d’un opéra : trois actes de longueur inégale mais finissant à chaque fois par un finale d’acte : un moment de culmination, une acmé émotionnelle.
Le personnage de N’éteins pas la lumière est une femme. Martin Servaz, le personnage principal de vos deux derniers romans, est plus en retrait. Parlez-nous de ce choix …
C’est le sujet qui a commandé la place de chaque personnage. J’avais déjà consacré un soin particulier aux personnages féminins dès Glacé : regardez ceux de Diane Berg et d’Irène Ziegler… Regardez aussi Marianne dans Le Cercle. Mais, cette fois, je voulais aller plus loin : je voulais que le personnage principal soit une femme.
De la même façon, j’ai choisi le domaine de la conquête spatiale, non seulement parce que Toulouse en est un des hauts lieux, mais parce que, contrairement à d’autres pays, la France n’a envoyé qu’une seule femme dans l’espace en trente ans, comme si c’était chez nous un domaine – un de plus ! – réservé aux hommes.
Je souhaitais également casser les clichés, ne pas faire de Christine une simple victime ou une simple ambitieuse, densifier et complexifier son personnage. Ce qui m’intéresse avant tout, en tant que romancier, ce sont les individus, pas leur sexe ou leur fonction, et surtout pas tel message à faire passer.
De son côté, Servaz n’est pas si en retrait que ça. Et il doit faire face à un ennemi plus redoutable que le plus retors des serial killers – un ennemi intérieur, un ennemi terrible. Un ennemi qui vous sépare du reste du monde.
Vos deux précédents romans ont connu beaucoup de succès… Ce succès a-t-il changé quelque chose dans votre vie ?
C’est vrai que ce qui s’est passé tout de suite avec Glacé a été et continue d’être incroyable. Et cela s’est confirmé avec Le Cercle. C’est un cadeau formidable pour un auteur que d’avoir un public tout de suite, dès le premier roman. Ce que cela a changé ? Tout ou presque. J’ai pris plus de fois l’avion et dormi dans plus d’hôtels depuis trois ans qu’au cours des cinquante années précédentes ! J’ai aussi rencontré plus de personnes (et comme je ne suis guère physionomiste et que j’ai une mémoire catastrophique pour les noms et les numéros de téléphone, cela me met parfois dans des situations embarrassantes). J’ai désormais la possibilité de consacrer à ma passion l’essentiel de mon temps. Vous n’imaginez pas ce que cela représente (ou peut-être que si). Dans La Métamorphose, Gregor Samsa se retrouve métamorphosé du jour au lendemain en cancrelat, je me suis retrouvé du jour au lendemain changé en auteur à plein temps : j’en goûte chaque minute. J’essaie de remercier les lecteurs de ce cadeau qu’ils m’ont fait par le travail, par la volonté de ne pas céder à la facilité, de chercher à écrire à chaque fois le meilleur livre possible – mais, au vrai, quand j’écris, je ne pense pas à tout ça ; j’essaie avant tout de m’amuser, de prendre ça comme un jeu très très sérieux. La seule chose que je regrette ? Que ni mon père ni ma mère n’aient vu mon bonheur tout neuf (ça s’est malheureusement joué à quelques jours près) : ils auraient été encore plus heureux que moi.