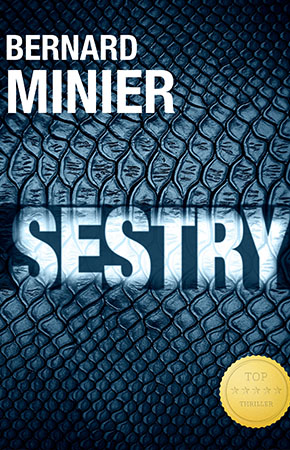Ambre et Alice Oesterman ont vingt et vingt et un ans. Elles se ressemblent comme des jumelles, malgré leur année d’écart. Très belles, très en avance pour leur âge, elles ont aussi quelque chose d’inquiétant et de mystérieux, comme si elles partageaient de terribles secrets. Elles sont aussi fans absolues d’un auteur de romans policiers bien plus âgé qu’elles et feraient n’importe quoi pour lui plaire. On les retrouve assassinées en 1993, vêtues en communiantes, dans un petit bois proche de la cité universitaire dans laquelle elles résident. Or le roman le plus célèbre de leur auteur préféré s’intitule précisément La Communiante…
Dans la première partie du roman en effet, on découvre un Servaz âgé de… vingt-quatre ans ! Il est confronté à sa première grosse affaire. Il a les cheveux longs, il est marié et a une petite fille de deux ans, Margot, celle-là même qui est une ado rebelle dans Glacé, une étudiante brillante dans Le Cercle et une jeune femme inquiète pour son père dans N’éteins pas la lumière. Pas mal de traits de la personnalité de Servaz que mes lecteurs connaissent vont s’éclairer ici. Puis, l’on retrouve le Servaz des romans précédents, celui qui, à la fin de Nuit, a été dégradé de commandant à capitaine. Le Servaz solitaire mais qui a désormais charge d’âme en la personne de Gustav, ce garçon de six ans, son fils… Je me suis beaucoup amusé avec ce Servaz à peine sorti de l’université, frais émoulu de l’école de police, qui se frotte aux réalités du terrain, du métier – et à la rugosité de ses collègues… J’y ai mis, reconnaissons-le, pas mal de moi-même au même âge. J’ai été un étudiant en médecine puis un fonctionnaire assez indocile et fantasque. D’ailleurs, croyez-le ou non, j’avais moi aussi les cheveux longs.
Aux côtés de ces deux sœurs, il y a ce personnage clef de votre intrigue : Erik Lang, un écrivain de polars à succès. Parlez-nous de cet auteur à la personnalité ambiguë et du rapport qu’il entretient à l’écriture et à ses lecteurs.
Erik Lang, je me dois de le préciser, n’est pas inspiré de mes collègues auteurs de polars qui sont, pour la plupart, des gens fort sympathiques et accessibles ! Erik Lang, au contraire, est arrogant, distant, vaniteux. Intelligent, brillant même, habile, retors, cultivé, cynique, il considère la plupart de ses contemporains – et, en particulier, les policiers qui l’interrogent – avec mépris. Il écrit des romans d’une grande noirceur et d’une grande cruauté, d’une violence quasi insoutenable, avec des personnages mus par des pulsions morbides, des romans aux conclusions souvent amorales, puisque le mal l’emporte sur le bien. Et c’est peut-être ce fond de méchanceté, de morbidité et de perversion qui a séduit les deux jeunes filles à l’âge où la transgression, le dépassement de ses peurs, le besoin d’être reconnu et aimé exercent le même attrait irrésistible que la lumière sur le papillon. Cela faisait longtemps que j’avais envie de développer ce personnage d’écrivain de polars. L’écriture, en soi, est une activité mystérieuse. Alors, imaginez un écrivain à l’encre très noire qui passe son temps à assassiner les gens dans des mises en scène toutes plus terribles les unes que les autres et jouer sur vos peurs. Je pense à des auteurs comme Edgar Allan Poe ou Lovecraft, dont les voix chuchotaient dans mes nuits adolescentes : on a fini par les confondre avec leurs œuvres, comme s’ils avaient vécu au milieu des créatures monstrueuses et des cauchemars qu’ils ont enfantés. Comme le dit Servaz, un écrivain entre, avec ses écrits, dans l’intimité de chaque lecteur. Cela crée un lien très particulier, très direct. Avec Sœurs, j’avais envie de parler du pouvoir des mots. Selon Freud, « avec des mots, on peut rendre quelqu’un heureux ou très malheureux, entraîner et convaincre, les mots provoquent des émotions, tout écrivain le sait, et permettent aux hommes de s’influencer les uns les autres ».
Cette enquête court sur deux époques : les années 1990 et maintenant.
Vous montrez à quel point le monde a changé en seulement deux décennies.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Comme tous ceux de ma génération et des générations précédentes, j’ai connu un monde sans Internet, sans téléphones portables, sans ordinateurs de bureau, sans jeux vidéo, sans Google, sans Facebook et sans Twitter, et même la télévision en noir et blanc avec deux chaînes ! Et – en dehors de cette dernière – ça n’est pas si vieux : j’avais trente ans. Je le répète : tout, absolument tout, a changé en vingt-cinq ans. Même nous. C’est de ça dont parle Sœurs. Prenez la police aujourd’hui, la plupart des enquêtes criminelles se fondent sur trois choses : l’ADN, la téléphonie mobile et les caméras de surveillance – aucune des trois n’intéressait la police française au début des années 1990, et il n’y avait pas non plus d’ordinateurs dans les bureaux. J’ai beaucoup parlé avec d’anciens flics ou des policiers proches de la retraite qui ont connu cette époque-là. Sœurs est aussi cela : une machine à remonter le temps, même si les deux tiers du livre se passent aujourd’hui.
Au-delà de la noirceur de l’intrigue, Sœurs est un roman qui parle aussi d’amour…
Sœurs est, paradoxalement, un hymne à plusieurs formes d’amour : et d’abord, celui du père au fils. On y découvre un peu plus la relation que Servaz entretenait avec son père – lequel s’est suicidé alors qu’il était étudiant : un épisode déjà évoqué dans Le Cercle mais qui prend une signification nouvelle dans Sœurs – et on y développe celle que Servaz père entretient avec son fils, Gustav, ce fils dont il ignorait l’existence jusqu’à Nuit. Où l’on voit que l’amour paternel peut prendre bien des formes et que la relation père-fils n’est jamais simple. Il est aussi question de l’amour des fans pour leur idole : ici l’écrivain Erik Lang. Certes, un écrivain n’est pas une star du rock, mais il attire aussi sur lui quelques fantasmes et peut cristalliser un certain nombre de désirs. Lang, en particulier, en joue, surtout avec Alice et Ambre. Compte tenu de ce qu’il écrit et de ce qu’il incarne, cet « amour » a des fondements plus que troubles. Et puis, il y a l’amour conjugal… l’amour qui se meurt… l’amour qui frappe comme la foudre… l’amour total aussi, qui pousse au sacrifice de soi et peut prendre les formes les plus surprenantes, comme on le verra au fil des pages. J’ai puisé dans quelque chose de très personnel pour les écrire – mais je n’en dirai pas plus, sinon que cette émotion et cette tension se ressentent, il me semble. J’espère que le lecteur achèvera ce livre la gorge nouée comme je l’ai eue moi-même en écrivant certaines pages. C’est un roman qui, je crois, va assez loin dans l’intime et dévoile des aspects de Servaz qui le rendront encore plus humain, encore plus attachant, même si je sais que quantité de lecteurs l’aiment déjà beaucoup.
Revenons à la première scène, très forte, de votre roman. Elle se passe dans une forêt. Après le froid et la neige, pourquoi le choix de ce nouveau décor ?
Je ne sais pas faire autrement. J’ai besoin d’un décor, d’une atmosphère pour démarrer. J’ai besoin de visualiser la scène ; je suis à la fois le metteur en scène, les acteurs, le décorateur, la script, le chef opérateur et j’ai un budget illimité : alors pourquoi me gêner ? La forêt, on le sait, symbolise l’inconscient, les choses cachées dans son obscurité, dans ses profondeurs. Ce n’est pas par hasard si ce sont deux jeunes filles qui s’y aventurent – comme, souvent, dans les contes. Depuis Glacé, où il y avait déjà un château blanc, une princesse endormie, un cheval, des personnages baptisés Grimm, Perrault… Mes romans, bien que réalistes et pointilleux en matière de techniques d’enquête et de police scientifique, sont aussi des « contes de fées pour adultes ». Et les contes, ça se passe souvent dans la forêt…
Vos livres sont traduits dans vingt langues. Quelle relation entretenez-vous avec vos lecteurs ?
Je vais vous faire une confidence : c’est un des aspects de mon métier que je préfère, aller à la rencontre des lecteurs. En France, dans les salons, les librairies. Mais aussi à l’étranger. J’ai côtoyé des lecteurs anglais, allemands, espagnols, polonais, tchèques, belges, suisses, autrichiens, sud-africains, mexicains, argentins, colombiens… Quel émerveillement de voir des histoires, si ancrées dans une réalité géographique et humaine particulière, parler à autant de gens différents, et que tous trouvent à s’identifier, d’une manière ou d’une autre, à ce personnage de Martin Servaz. Qu’un lecteur polonais ou argentin puisse me confier qu’il aime Servaz et qu’il a l’impression de le connaître m’étonne toujours. Mais après tout, et toutes proportions gardées, le lecteur que je suis s’est bien identifié, au fil des ans, à Jim Hawkins, à Tom Sawyer ou à Stingo, le jeune apprenti écrivain du Choix de Sophie…